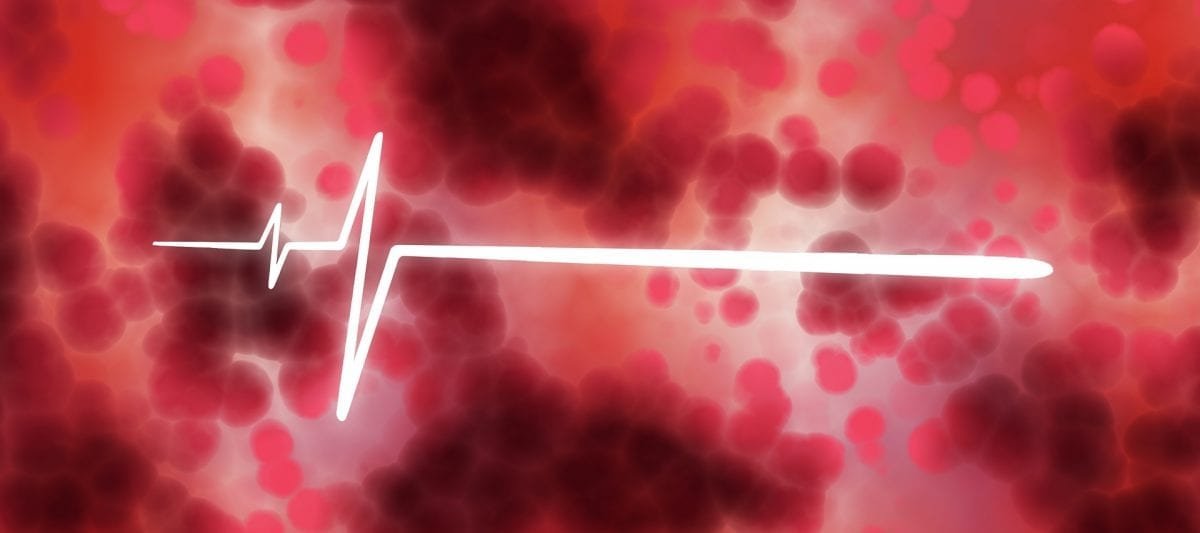En France et généralement dans les autres pays industrialisés, l’arrêt circulatoire constitue un problème de santé publique majeure. Pour le cas de la France, cette pathologie tue environ 50 000 personnes par an, le plus souvent hors des centres de soins. Si l’inexistence d’une prise en charge rapide et efficace explique en grande partie ce nombre alarmant, force est de constater que l’imprévisibilité et le caractère général de l’arrêt circulatoire y sont également pour beaucoup : il peut frapper n’importe qui à n’importe quel moment.
À la source des battements du cœur
Comme on le sait tous, le cœur bat à un rythme régulier dit sinusal. À l’origine de cela : de petits signaux électriques produits par le nœud sinusal situé au niveau de l’oreillette droite. Ces signaux se diffusent d’abord dans les oreillettes pour être freinés par le nœud d’Ashoff-Tawara (nœud atrioventriculaire ou auriculo-ventriculaire). Cela entraine la systole auriculaire (contraction des oreillettes) et empêche les oreillettes et les ventricules de se contracter en même temps.
Depuis le nœud d’Ashoff-Tawara, les signaux passent par le faisceau de His et le réseau de Purkinje pour déclencher la contraction des ventricules. Avec un cœur en rythme sinusal, les oreillettes se contractent avant les ventricules. Mais lorsque le cœur est en fibrillation ventriculaire, tout devient anarchique et désorganisé.
Qu’est-ce que l’arrêt circulatoire ?
Il y a arrêt circulatoire (arrêt cardiaque ou arrêt cardio-respiratoire) en cas d’absence de toute activité cardiaque efficace, ce qui conduit à l’arrêt du drainage du sang vers les organes vitaux. En France, les chiffres sur l’arrêt circulatoire sont alarmants. Et pour cause, il ferait plus de 200 victimes par jour et les chances d’y survivre ne dépassent pas les 4 %.
Des chiffres compréhensibles si l’on pense à la résistance des organes à l’anoxie (manque d’oxygène dans le sang) :
- 3 minutes pour le cerveau ;
- 20 minutes pour le cœur ;
- 45 minutes pour les reins ;
- 60 minutes pour le foie ;
À l’ECG, l’arrêt circulatoire peut se présenter sous 3 formes :
- Tracé plat : arrêt des contractions des fibres myocardiques ;
- AESP ou activité électrique sans pouls : tracé déformé et arrêt de la circulation sanguine. Dans ce cas, l’arrêt circulatoire est souvent le résultat d’un pneumothorax ou d’un désamorçage par hémorragie massive ;
- Fibrillation ventriculaire : seule une défibrillation rapide peut sauver la victime. Toutefois, les chances de survie s’amenuisent rapidement si la défibrillation tarde à se faire ;
Facteurs de risques
Certaines catégories de personne sont plus exposées à l’arrêt circulatoire que d’autres. Ce sont notamment :
- Les personnes qui ont eu un infarctus du myocarde ;
- Les personnes qui ont souffert d’une insuffisance cardiaque ;
- Les personnes qui ont survécu à un arrêt circulatoire ;
- Les personnes possédant des proches qui ont souffert d’arrêt circulatoire ;
- Les personnes qui ont une fraction d’éjection anormalement basse. Pour rappel, la fraction d’éjection est la proportion de sang expulsée par le cœur à chaque battement ;
Notez qu’il est possible d’estimer le risque pour une personne de subir un arrêt circulatoire en lui faisant passer plusieurs examens diagnostiques : ECG, épreuve d’effort, exploration du cœur par sonde (cathétérisme cardiaque)…